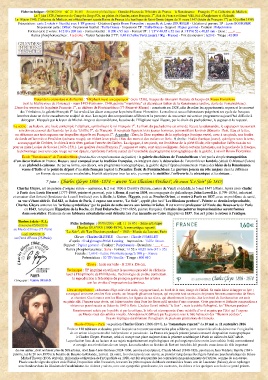Page 6 - Journal Culturel de Metz - 2016-06
P. 6
Fiche technique : 06/06/2016 - réf. 21 16 401 - Souvenir philatélique : Grandes Heures de l'Histoire de France – la Renaissance – François 1er et Catherine de Médicis.
Le 7 juin 1520, l'entrevue du Camp du Drap d'Or, en plaine de Flandre, entre François 1er, Roi de France et Henri VIII, Roi d'Angleterre et d'Irlande.
Le 10 juin 1549, Catherine de Médicis, est officiellement sacrée Reine de France à la basilique de Saint-Denis (règne du 31 mars 1547 (décès de François 1er) au 10 juillet 1559)
Présentation : carte 2 volets + 1feuillet avec 1 TP gommé - Création d'après Rosso Fiorentino : aquarelle de Louis BOURSIER - Création et gravure TP : Louis BOURSIER
Impression carte : Offset - Impression feuillet : Taille-Douce - Impression TP : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie
Format carte 2 volets : H 210 x 200 mm - Format feuillet : H 200 x 95 mm - Format TP : 1 TP V 40,85 x 52 mm et 1 TP H 52 x 40,85 mm - Dent. : ___x ___
Barres phosphorescentes : 1 à droite - Valeur faciale des 2 TP : 1,40 € (Lettre Verte jusqu'à 100g - France) - Prix du souvenir : 6,20 € - Tirage : 42 000
Visuel de la couverture et du feuillet : "Éléphant royal au caparaçon" (vers 1536), fresque de Giovanni Battista di Jacopo dit Rosso Fiorentino
(soit le Maître roux de Florence) - mars 1495-Paris nov. 1540, peintre "maniériste" et décorateur italien de la Renaissance tardive, école de Fontainebleau).
L'une des œuvres de la galerie François 1er, au château de Fontainebleau (77-Seine-et-Marne) : construite en 1528, afin de relier les appartements royaux et le couvent
des Trinitaires, la galerie François Ier fut ornée d’un décor conçu par le peintre Rosso Fiorentino. Le maître et ses collaborateurs peignirent un cycle de fresques
inscrites dans un riche encadrement sculpté de stuc. Les sujets des compositions célébraient la personne du souverain suivant un programme aujourd’hui difficile à
décrypter. Marquée par la leçon de Michel-Ange et du maniérisme, la scène de l’Éléphant royal illustre, par le choix du pachyderme, la sagesse et la royauté.
La scène : au balcon, une foule contemple l’éléphant, symbolisant le roi François 1er. Le front du pachyderme est orné de l'écu à la salamandre, le caparaçon recouvrant
son dos est couvert de fleurs de lys et du "chiffre F", de François. À ses pieds figurent trois jeunes hommes, personnifiant les trois éléments : l'air, l'eau et le feu,
en référence aux trois espaces sur lesquelles règne le roi François Ier. A gauche : Zeus, le Dieu suprême de la mythologie (tunique verte), avec à ses pieds, son foudre
de dards enflammés et Poséidon (cuirasse rouge), un trident à ses pieds, Dieu des mers et des océans en furie. A droite : Hadès (tunique jaune), qui règne sous la terre,
accompagné de Cerbère, le chien à trois têtes gardant l'entrée des Enfers. La cigogne, à ses pieds, est l'emblème de la piété filiale, elle symbolise l'affection du roi
pour sa mère Louise de Savoie (1476-1531). Les qualités du roi François Ier, sagesse et vertu, sont ainsi soulignées. Selon certains historiens, sur la gauche de la fresque,
le personnage avec une cape rouge sur son épaule, représente l’artiste auteur de l’ensemble du programme iconographique de la galerie, à savoir Rosso Fiorentino.
Ecole "Renaissance" de Fontainebleau (fond du bloc et représentation du feuillet) : la galerie du château de Fontainebleau n’est pas la simple transposition
d’un décor italien en France. Rosso a aussi composé avec la tradition française, en intégrant dans la décoration de l’ensemble un lambris (détail © Manuel Cohen)
et un plafond à caissons. De par sa forme, ses décors, son programme iconographique, la galerie signe l’épanouissement en France des idées de la Renaissance
venue d’Italie et le point de départ d’un style français baptisé la Première École de Fontainebleau. La gravure jouera un rôle majeur dans la diffusion
en Europe de ce nouveau vocabulaire, bientôt adopté par tous les arts, y compris le mobilier, l'orfèvrerie, la céramique et les émaux...
7 juin : Charles Gleyre 1806 -1874 – œuvre "Les Illusions Perdues", dit aussi "Le Soir" (de 1843)
Charles Gleyre, est un peintre d'origine suisse – naissance, le 2 mai 1806 à Chevilly (Suisse, canton de Vaud) et décédé, le 5 mai 1847 à Paris. Après avoir étudié
à Paris chez Louis Hersent (1777-1860, peintre et graveur), puis à Rome, il part en 1834, en compagnie du philanthrope John Lowell Jr. (1799-1836), industriel
et amateur d'art fortuné (fondateur de Lowell Institute) vers la Sicile, la Grèce, l'Egypte, puis au Proche-Orient, et rentre à Paris en 1837, avec un problème de santé,
sa vue s'étant altérée. En1843, au Salon de Paris, il expose son œuvre, "Le Soir", appelé plus tard "Les Illusions perdues". Peintre au dessin irréprochable,
Charles Gleyre annonce les "artistes symbolistes" par la poésie de cette œuvre aux teintes irréelles. Il est nommé professeur à l'Ecole des Beaux-arts de Paris
en 1843, remplaçant Hippolyte de la Roche, dit Paul Delaroche (1797-1856, peintre français). Certains des peintres impressionnistes seront formés
dans son atelier. Plusieurs de ses tableaux orientalistes sont détruits lors d'un incendie au Caire (Egypte) en 1837. Son art prône le retour à l'antique.
Timbre à date - P.J.: Fiche technique : 07/06/2016 - réf. 11 16 051 - Série artistique
dimanche 05/06/2016 Charles GLEYRE (1806-1874), le romantique repenti.
au Musée d'Orsay (75-Paris)
"Le Soir", dit "Les Illusions perdues" - 1843 - Musée du Louvre, Paris
lundi 06/06/2016 Œuvre : Charles GLEYRE – Gravure : Claude JUMELET
au Carré d'Encre (75-Paris)
d’après : © akgimages /Erich Lessing - Impression : Taille-Douce
Conçu par : Valérie BESSER Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie - Dentelure : ___ x ___
Barres phosphorescentes : Sans - Format : H 52 x 40,85 mm (47 x 35)
Faciale : 1,60 € - Lettre Prioritaire jusqu'à 100 g - France
Présentation : 30 TP / feuille - Tirage : 800 010
Œuvre : huile sur toile - H 238 x 156 cm.
Technique : TP imprimé en utilisant le nouveau procédé de clicherie
laser à l'Imprimerie de Phil@poste. Technologie de pointe permettant
la reproduction à l'identique du poinçon gravé par les artistes
sur les viroles d'impression des timbres.
L'œuvre représente : un homme d'âge mûr s'est assis, voyageur lassé, au bord de la mer, image de l'infini. Sa main laisse échapper sa lyre ;
son regard se tourne vers les flots azurés, sur lesquels glisse une barque, qui emporte tout un essaim de jeunes femmes couronnées de fleurs
et chantant. Ces femmes sont les Illusions, les figures de ses rêves, qui abandonnent le poète. Sur le rebord de l'embarcation est assis
un génie ailé, l'Amour sans doute, qui laisse tomber dans l'eau les fleurs qu'il arrache d'une couronne. Cette gracieuse et littéraire composition a
obtenu un grand succès au Salon de 1843 à Paris. L'auteur l'avait intitulé "le Soir" ; mais le public l'a baptisé, les "Illusions perdues".
Unanimement saluée par le public et par la critique, la toile est récompensée d'une médaille d’or et acquise par l'Etat qui l’expose
au Musée royal des artistes vivants. Abondamment diffusée par la gravure sous le titre balzacien des "Illusions perdues",
l'œuvre imprègne durablement l'imaginaire de plusieurs générations de Français.
Musée d'Orsay – Paris : exposition Charles Gleyre (1806-1874). Le "romantique repenti" du 10 mai au 11 septembre 2016
Environ 120 tableaux et dessins, parmi lesquels se trouvent ses œuvres les plus célèbres, sont rassemblés afin de démontrer l’originalité
de cet artiste à la personnalité indépendante et paradoxale. La France n'a jusqu'à présent jamais consacré d'exposition monographique
à Charles Gleyre. Pourtant, celui-ci occupe une place majeure dans la peinture académique à Paris au milieu du XIXe siècle.
La perfection lisse de sa facture et ses sujets majoritairement mythologiques ont pu longtemps faire croire à un esthète froid, conventionnel
et aveugle aux révolutions de son temps. Les recherches en histoire de l'art ont toutefois fait prendre conscience du rôle important
de son atelier, dont sortirent plus de 500 artistes, dont Jean-Léon Gérôme (1824-1904, peintre et sculpteur), Claude Monet (1840-1926, peintre) ou Jean Fréderic Bazille (1841-
peintre, tué le 28 nov.1870 à la bataille de Beaune-la-Rolande, Loiret). En outre, les relectures de son œuvre, au premier rang desquelles figure l'analyse psychanalytique du Suisse
Michel Thevoz (1936, écrivain, philosophe et historien de l'art) publiée en 1980, ont fait réapparaître les contradictions passionnantes de l'artiste, comme de son œuvre.
Placée sous le signe du spleen et de l'idéal, l'exposition offre l'occasion, à travers les prêts majeurs du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (Suisse), de se replonger
avec bonheur dans les illusions de l'académisme. Le visiteur y suivra, avec une sympathie grandissante, les aventures, les échecs et les quelques succès de ce grand peintre.