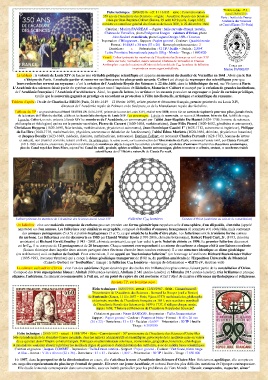Page 10 - Journal Culturel de Metz - 2016-06
P. 10
Fiche technique : 29/06/2016 - réf. 11 16 035 – série : Commémoration Timbre à date - P.J. :
350 ans de l'Académie des Sciences - origine : Académie Royale des Sciences mardi 28/06/2016
créée par Jean-Baptiste Colbert (Reims, 29 août 1619-paris, 6 sept.1683), Paris : Institut de France
ministre et contrôleur général des finances de Louis XIV, le 22 décembre 1666 Académie des Sciences
et Carré d'Encre (75-Paris)
Création : Marion FAVREAU – d'après : huile sur toile d'Henri Testelin,
Château de Versailles, photo Bridgeman Images – ceinture d'Orion, photo Conçu par :
Marion FAVREAU
John Sanford et molécule, photo Laguna Design / SPL / Cosmos
Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Couleur : Quadrichromie
Format : H 40,85 x 30 mm (37 x 26) - Barres phosphorescentes : 2
Dentelure : ___ x ___ Présentation : 42 TP / feuille – Faciale : 2,50 €
Lettre Prioritaire Internationale jusqu'à 100 g - Monde - Tirage : 1 000 020
Visuel : Colbert présente les membres de l’Académie des Sciences au roi Louis XIV
Huile sur toile, Versailles, musée national, Château de Versailles et Trianon
Arrière plan : vue de la ceinture d'Orion et de la molécule C240 Isomères de fullerène
imprimée en encre argent métallisée.
Le tableau : la volonté de Louis XIV de lancer une véritable politique scientifique est apparue au moment du chantier de Versailles en 1661. Alors que le Roi
s’éloigne de Paris, il souhaite garder et resserrer ses liens avec les plus grands savants. Colbert est chargé de regrouper des scientifiques pour que
leurs recherches servent au royaume : c’est la création de l'Académie Royale des Sciences le 22 déc.1666, dans la bibliothèque du roi, rue Vivienne à Paris.
L’Académie des sciences faisait partie du système mis en place sous l’impulsion de Richelieu, Mazarin et Colbert et marqué par la création de grandes institutions,
de l’Académie française à l’Académie d’architecture. Ainsi, les gens de lettres, les artistes et les savants pouvaient se regrouper et jouir de certains privilèges,
tandis que le souverain gagnait en prestige en accordant sa protection à l’élite intellectuelle, artistique et scientifique du royaume.
Tableau d'après : l'école de Charles Le BRUN (Paris, 24 fév.1619 – 12 février 1690), artiste-peintre et décorateur français, premier peintre du roi Louis XIV,
directeur de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, et de la Manufacture royale des Gobelins.
Tableau du TP : ce grand tableau d'Henri TESTELIN (1616-1695, peintre de la cour de Louis XIV), réalisé vers 1680, est en fait un carton de tapisserie pour une pièce, jamais tissée,
de la tenture de l’Histoire du Roi, célébrant les hauts faits du règne de Louis XIV. Les personnages : à droite du souverain, on reconnaît Monsieur, frère du Roi, habillé de rouge.
à gauche, Colbert, en noir, présente à Louis XIV les membres de l’Académie, en commençant par l’abbé Jean-Baptiste Du Hamel (1624-1706, homme de sciences,
philosophe et théologien) qui en est le premier secrétaire, Pierre de Carcavi (1600-1684, mathématicien), Jean-Félix Picard (1620-1682, géodésien et astronome),
Christiaan Huygens (1629-1695, Néerlandais, mathématicien, physicien et astronome), Jean-Dominique Cassini 1er (1625-1712, astronome et ingénieur), Philippe
de La Hire (1640-1718, mathématicien, physicien, astronome et théoricien de l'architecture), l’abbé Edme Mariotte (1620-1684, chimiste, physicien et botaniste)
et Jacques Borelly (1623-1689, médecin, chimiste, mathématicien, astronome). Derrière Colbert, on reconnaît Charles Perrault (1628-1703, homme de lettres
et auteur), son premier commis, tenant un livre. En arrière plan : la scène ouvre, sur la construction de l'Observatoire de Paris, commencé l'année 1667, par Claude Perrault
(1613-1688, médecin, anatomiste, physicien et architecte), de nombreux objets évoquent les activités scientifiques : squelettes d’animaux illustrant les dissections anatomiques,
plan du Canal royal des Deux-Mers, aujourd’hui Canal du midi, pendule, sphère armillaire, lunette astronomique, globes terrestres et célestes, sextant, et nombreux traités
scientifiques dont l’Histoire naturelle de Claude Perrault.
Colbert présente les membres de l’Académie des Sciences au roi Louis XIV Fullerène C240 Isomères Ceinture d'Orion (astérisme au sein de la constellation)
Un fullerène : c'est une molécule composée de carbone pouvant prendre une forme géométrique rappelant celle d'une sphère, d'un ellipsoïde, d'un tube (appelé
nanotube) ou d'un anneau. Les fullerènes sont similaires au graphite, composé de feuilles d'anneaux hexagonaux (6 sommets et 6 côtés) liés, mais contenant
des anneaux pentagonaux (5 et 5) et parfois heptagonaux (7 et 7), ce qui empêche la feuille d'être plate. Les fullerènes sont la troisième forme connue
du carbone. Les fullerènes ont été découverts en 1985 par Harold Walter Kroto (1939-2016, chimiste britannique), Robert Floyd Curl, Jr. (1933, chimiste
américain) et Richard Errett Smalley (1943 - 2005, chimiste américain), ce qui leur valut le prix Nobel de chimie en 1996. Le premier fullerène découvert
est le C60, il se compose de 12 pentagones et de 20 hexagones. Chaque sommet correspondant à un atome de carbone et chaque côté à une liaison covalente
(liaison chimique dans laquelle deux atomes partagent deux électrons d'une de leurs couches externes). Il a une structure identique au dôme géodésique
(en architecture) ou à un ballon de football. Pour cette raison, il est appelé un "buckminsterfullerène" (en hommage à l'architecte Richard Buckminster Fuller
(1895-1983, inventeur futuriste) qui a conçu le dôme géodésique transparent de Ø 80 m, du pavillon américain de l'Exposition Universelle de Montréal
(Canada-Québec) ou "footballène". (image : le fullerène C240 Isomères - énergie de déformation = 45,871 eV, électron-volt)
La ceinture ou baudrier d'Orion : c'est l'un des astérisme (figure dessinée par des étoiles très brillantes) les plus connus, faisant partie de la constellation d'Orion.
Composé des trois supergéantes bleues : Alnitak (800 années-lumière), Alnilam (1340 années-lumière) et Mintaka (915 années-lumière), très brillantes et presque
alignées, l'astérisme, facilement reconnaissable à l'œil nu, est un point de repère du ciel nocturne et fait l'objet de maintes références mythologiques et religieuses.
Anciens TP, sur le même sujet :
Fiche technique : 06/06/1966 - retrait : 11/03/1967 - Série - Commémoratif :
Tricentenaire de l'Académie des Sciences - Bernard Le Bouyer (ou Le Bovier)
de Fontenelle (Rouen, 11 fév.1657 – Paris, 9 janv.1757) mathématicien, philosophe
et écrivain, membre de l'Académie française en 1691, puis secrétaire perpétuel
de l'Académie Royale des Sciences de 1699 à 1737, il rédigea chaque année,
depuis 1699, "Histoire et Mémoires de l'Académie Royale des Sciences"
Création et gravure : Pierre GANDON - Impression : Taille-Douce rotative
Support : Papier gommé - Couleur : Pourpre et bistre - Format : H 40 x 26 mm
(36 x 22) - Dentelures : 13 x 13 - Faciales : 0,60 F – Présentation : 50 TP / feuille
Tirage : 6 380 000
Fiche technique : 28/05/1973 - retrait : 11/01/1974 - Série - Commémoratif : 50e anniversaire de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer
Née au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les milieux administratifs et scientifiques, préoccupés de la meilleure mise en valeur
de ce qui était alors l'Empire colonial français. Politiques et administrateurs coloniaux, économistes, géographes, historiens, ethnologues
et naturalistes voulaient aboutir à préciser les meilleurs règles de gestion et d'administration des territoires, avec de solides bases scientifiques.
Création et gravure : Jacques COMBET - Impression : Taille-Douce rotative - Support : Papier gommé - Couleur : Vert foncé, bistre rouge
et lilas - Format : V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelures : 13 x 13 - Faciales : 1,00 F – Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 7 650 000
En 1957, dans la perspective de la décolonisation en cours, elle s'attribua le nom d'Académie des Sciences d'Outre-Mer. Strictement apolitique, elle compte en
ses rangs des représentants du plus large éventail de pensée. Elle reste une jeune Académie, et a réussi l'une des plus difficiles mutations de l'époque contemporaine.
Elle étudie le monde contemporain dans son ensemble, avec un intérêt particulier pour les problèmes du Tiers Monde : "Savoir, comprendre, respecter, aimer"