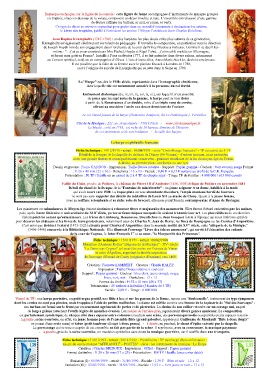Page 6 - Journal Culturel de Metz - 2014-05
P. 6
Remarque technique, sur la figure de la console : cette figure de faune accompagnée d’instruments de musique groupés
en trophée, situés en dessous de la volute, composent un décor insolite et rare. L’ensemble est rehaussé d’une gamme
de dorure raffinée (or brillant, or mat, or jaune, or vert).
Ce type de décor se retrouve cependant pour partie dans un recueil d’ornements à destination des artistes,
le Livre des trophées, publié à Paris dans les années 1780 par l’architecte Jean-Charles Delafosse.
Jean Baptise Krumpholtz (1747-1790) : un des harpistes les plus doués et les plus estimés de sa génération,
Krumpholtz est également célébré pour ses talents de pédagogue. Il travaille la composition, en particulier sous la direction
de Joseph Haydn lors de son engagement dans l’orchestre de la cour du Prince Nicolas à Estheraz. Comme il se décrit lui-
même : "…j’ai eu pour coopérateurs Mrs Püchel, Haydn et Rigel l’aîné…j’ai meublé ma tête en Allemagne,
et formé mon goût en France". Installé à Paris en février 1777, il se fait entendre dans divers salons, notamment
au Concert spirituel, seul, ou en compagnies d’élèves. L’une d’entre elles, Anne-Marie Steckler, devient son épouse.
Il est possible que la fuite de sa femme avec le pianiste Dussek à Londres en 1788,
soit à l’origine du suicide de Krumpholtz qui se jette dans la Seine en 1790.
La "Harpe" est, dès le VIIIe siècle, représentée dans l’iconographie chrétienne,
dans laquelle elle est notamment associée à la personne du roi David.
Instrument diatonique (do, ré, mi, fa, sol, la, si.), sur lequel il n’est possible
de jouer que les sept notes de la gamme, la harpe peut se voir doter
à partir de la Renaissance d’un double, voire d’un triple rang de cordes,
offrant au musicien l’accès aux douze demi-tons de l’octave.
Le roi David jouant de la harpe (Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin )- Versailles
Cité de la Musique : 221, av. Jean-Jaurès - 75019 Paris - www.citedelamusique.fr
Le Musée , créé en 1793, est riche de 56 harpes, témoins de l'histoire
de cet instrument et de son évolution - la salle des harpes
La harpe en philatélie française
Fiche technique : 14/12/1970 - retrait : 06/08/1971 - série "Croix-Rouge française" - TP ou carnet de 8 TP
Détail de la fresque de la chapelle du château de Dissay (86-Vienne) - d'auteur inconnu, mais exécutées
avec une grande finesse et remarquablement conservées - peinture attachante de la fin du moyen-âge en Poitou.
A droite, au premier plan : une harpe ou une lyre
Dessin et gravure : Pierre GANDON - Impression : Taille-Douce rotative - Support : Papier gommé - Couleur : Vert et croix rouge Format
: V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelures : 13 x 13 - Faciale : 0,40 F + 0,15 F surtaxe au profit de la C.R. française
Présentation : 50 TP / feuille ou en carnet de 2 x 4 TP de chaque sujet - Tirage TP de feuilles : 4 600 000 / 613 000 carnets
Vallée du Clain, proche de Poitiers, le château de Pierre III d'Amboise (1450-1505) évêque de Poitiers en novembre 1481
Détail du visuel de la fresque de la "Fontaine de miséricorde" : un jeune seigneur et sa dame, habillés à la mode
qui avait cours vers 1500. La toque plate sur une abondante chevelure, l'ample manteau bordé de fourrure
ne sont pas sans rappeler des détails du médaillon de Louis XII au musée de Cluny. Quant à la jeune femme,
avec sa coiffure retombante et sa riche robe de brocart, elle nous paraît bien la contemporaine d'Anne de Bretagne.
Les miniatures ou enluminures du Moyen-âge étaient destinées à rehausser titres et majuscules des manuscrits. Elles furent d'abord exécutées par les moines,
puis, après l'essor littéraire et universitaire du XIIIe siècle, par les artisans laïques auxquels ils avaient transmis leur art. Les plus célèbres de ces derniers
étaient peintres autant qu'enlumineurs. Les frères de Limbourg, Beauneveu, Bourdichon ou Jean Fouquet furent à l'époque qui nous intéresse appelés
pour décorer les châteaux et les livres de leurs protecteurs, notamment ceux de Charles V, Jean de Berry, les Ducs de Bourgogne ou les Comtes d'Angoulême.
C'est ainsi que Robinet Testard (1475-1523) exécuta pour Charles d'Angoulême dans la seconde moitié du XV" siècle, cette "allégorie de la Musique"
(1496-1498) conservée à la Bibliothèque Nationale. Elle illustrait l'ouvrage "Livre des échecs amoureux", qui servit à l'éducation des enfants
de la cour de Cognac, le futur François 1er et sa sœur, "la Marguerite des Princesses".
Fiche technique : 15/01/1979 - retrait : 08/02/1980
Miniature d'Antoine Rollin "allégorie de la Musique" - XVᵉ siècle.
"La Dame aux Cygnes" est peut-être assise sur l'oiseau de Vénus
et celui d'Apollon, rappelant la double inspiration
de l'ouvrage d'Evrard de Conty (originaire d'Amiens) vers 1400.
Création : Pierrette LAMBERT – Gravure : Claude HALEY
Impression : Taille-Douce rotative 6 couleurs
Support : Papier gommé - Couleur : bleu clair, jaune orangé, rouge,
brun, vert, noir – Dentelure : 13 x 12
Format du timbre : H 52 x 41 mm (48 x 37)
Présentation : 25 timbres à la feuille (5 bandes de 5 TP)
Faciale : 2,00 F - Tirage : 6 000 000
Visuel du TP : une harpe portative, un petit orgue positif, une flûte à bec et sur les genoux de la Dame, repose une "doulcemelle", instrument du type tympanon
dont les cordes ne sont pas pincées, mais frappées à l'aide de petites mailloches. La dame est coiffée comme une femme de la tapisserie du "Bal des Sauvages" :
son turban est fermé sur le front par un ornement agrémenté de perles et de pierreries. La chaine de son collier retombe sur un corsage uni, auquel
de larges galons rattachent l'étoffe légère de manches évasées. Les scènes de l'arrière-plan, représentent divers genres musicaux. La composition
est parfaitement symétrique; de chaque côté deux espaces entre colonnes encadrent une scène, des personnages isolés occupant les petits espaces restants :
à gauche, scène courtoise, en effet, un jeune homme joue de l'ensemble flûte (grand galoubet, appelée par Guillaume de Machault "flûte à deux doigts"
se jouant d'une seule main) et tabor (petit tambour allongé à deux peaux) - à droite, en pendant, le chant d'église exécuté par la chapelle.
Le personnage qui se trouve auprès de cet ensemble ne fait pas partie de la scène. Il représente, avec sa cornemuse, la musique paysanne
- à gauche, près de la scène courtoise, un musicien symbolise sans doute la musique guerrière, car il souffle dans une trompette.
Fiche technique : 31/01/1992 - retrait : 30/11/1992 - Préoblitérés : TP surchargé d'une oblitération :
un arc de cercle marqué "AFFRANCHts – POSTES" - série : les instruments de musique : La Harpe
Création : Charles BRIDOUX - Impression : Offset - Support : Papier gommé
Format du timbre : V 20 x 26 mm (17 x 23) - Présentation : 100 TP / feuille (avec coins datés)
Emission (I) : 06/09/1989 - retrait : 31/10/1990 - Faciale : 1,39 F – Bleu et noir – 12 x 12
Emission (III) : 02/07/1990 - retrait : 31/03/1992 - Faciale : 1,93 F – Vert jaune et noir – 13 x 13