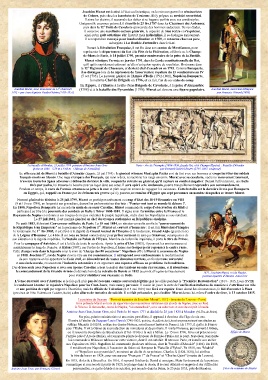Page 6 - Journal Culturel de Metz - 2017-06
P. 6
Joachim Murat, sous-lieutenant au 12e chasseurs ,Joachim Murat est destiné à l'état ecclésiastique, on le retrouve parmi les séminaristes Joachim Murat, maréchal d'Empien
1792 – par Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855) par François Gérard (1804)
de Cahors, puis chez les lazaristes de Toulouse. Il s'y prépare au noviciat sacerdotal.
Il aime les plaisirs, il accumule des dettes et se bagarre parfois avec ses condisciples.
Craignant le courroux paternel, il s'enrôle le 23 fév.1787 dans les Chasseurs des Ardennes,
puis dans la 12e Unité de Cavalerie qui recrute des hommes audacieux. De ses études,
il conserve une excellente culture générale, la capacité de bien écrire et s'exprimer,
ainsi qu'un goût artistique sûr. Instruit mais indiscipliné, il se distingue rapidement.
Il est cependant renvoyé pour insubordination en 1789, et retourne chez son père,
aubergiste à La Bastide-Fortunière dans le Lot.
Durant la Révolution Française, il est élu dans son canton de Montfaucon, pour
représenter le département du Lot à la Fête de la Fédération, célébrée su le Champ-
de-Mars de Paris, le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille.
Murat réintègre l'armée en janvier 1791, dans la Garde constitutionnelle du Roi,
qu'il quitte rapidement estimant qu'elle n'est qu'un repaire de royalistes. Il retourne dans
le 12e Régiment de Chasseurs, et devient chef d'escadron en 1793. Comme Bonaparte,
il se distingue lors de la répression de l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV
(5 oct.1795). Le nouveau général de l'Armée d'Italie (1792-1801), Napoléon Bonaparte,
le nomme Chef de Brigade en 1796, et en fait, l'un de ses aides de camp.
En Egypte, il s'illustre à la tête d'une Brigade de Cavalerie, à la prise d'Alexandrie
(1798) et à la bataille des Pyramides (1798). Murat est devenu une figure populaire.
La bataille d'Aboukir, 25 juillet 1799 .peinture d'Antoine-Jean Gros Paris - Arc de Triomphe (1806-1836, façade Est, côté Champs-Elysées) : Bataille d'Aboukir
(peint en 1806 - 5,78 m x 9,68 m - Château de Versailles) par Bernard Gabriel Seurre (1795-1867, sculpteur)
Le rôle crucial de Murat à bataille d’Aboukir (Egypte, 25 juil.1799) : le général ottoman Mustapha Pacha sort du fort avec ses hommes et coupe les têtes des soldats
français morts ou blessés. Une rage s’empare des Français, qui sans ordres, se ruent sur les rangs ennemis. Murat avec sa cavalerie, opère un mouvement tournant,
traverse toutes les lignes adverses et débouche derrière la ville, coupant la retraite au général, qu’il capture en combat singulier. Durant l'affrontement, une balle
tirée par pacha, lui traverse la bouche pour se loger dans ses cotes. Il sera opéré et le lendemain, pourra tranquillement reprendre son commandement.
Pendant ce temps, le reste de l’armée ottomane se jette à la mer et périt noyé en tentant de regagner les vaisseaux. Cette bataille est la dernière livrée par Bonaparte
en Égypte, qui, rappelé en France par les événements graves qui s'y passent, ne ramène d'Égypte que sept personnes au nombre desquelles se trouve Murat.
Nommé général de division le 25 juil.1799, Murat va participer activement au coup d'Etat des 18-19 Brumaire an VIII 1811, Joachim Murat, roi de Naples,
(9 et 10 nov.1799), en lançant à ses grenadiers, devant les parlementaires éberlués : "Foutez-moi tout ce monde-là dehors !". portrait équestre d'Antoine-Jean Gros
En 1800, Napoléon Bonaparte lui accorde la main de sa sœur Caroline. Murat commande le corps d'observation du Midi et
participe à ce titre à la poursuite des combats en Italie à l'hiver 1800-1801. Il signe ainsi l'armistice entre la France et le
Royaume de Naples et ordonne à ses troupes de ne pas violenter le peuple napolitain, ordre dont les Napolitains se souviendront.
Le 27 juil.1801, il est nommé général en chef des troupes stationnées en République cisalpine.
En août 1803, il devient Gouverneur militaire de Paris. Le 18 mai 1804, un sénatus-consulte confie le "gouvernement de
la République à un Empereur" en la personne de Napoléon 1er. Murat est couvert d'honneurs : il est fait Maréchal d'Empire
le lendemain. Le 1er fév.1805, il est élevé à la dignité de Grand Amiral de l'Empire et le lendemain, Grand Aigle (grand croix)
de la Légion d'Honneur. Le 4 fév. il est reçu au Sénat conservateur pour prêter serment en tant que Sénateur, conséquence de
son élévation à la dignité impériale. Il s'installe au Palais de l'Elysée. Membre de la famille impériale, il porte le titre de Prince.
Pour la campagne d'Autriche, il est à la tête de toute la cavalerie. Après la prise d'Ulm (1805), il poursuit les armées russes et
autrichiennes le long du Danube. A Eylau (1807), sur l'ordre de Napoléon, il lance ses troupes pour repousser le centre russe.
Cette charge reste dans la légende sous le nom de "charge des 80 escadrons". Napoléon offre à Murat la couronne de Naples
en 1808. Joachim Ier, roi de Naples s'avère être un roi consciencieux. Il entreprend avec enthousiasme la modernisation
de son royaume en lui apportant le Code civil, en démembrant de vastes domaines terriens, en fondant une université
et une école navale, en soutenant l'industrie cotonnière et en apportant une réponse efficace au problème du banditisme.
Des désaccords avec Napoléon et avec son épouse Caroline créent toutefois des tensions au sein du royaume, et il abandonne
le commandement de la Grande Armée en déroute lors de la retraite de Russie en 1812 (au profit d'Eugène de Beauharnais)
pour rentrer stabiliser son royaume en Italie.
L'échec du traité avec l'Autriche et le fait qu'il n'ait pas été reconnu comme souverain légitime par les alliés pendant la "Première Restauration" (1814 - 1815, Louis XVIII)
le conduisent à tenter de rejoindre Napoléon pour les Cent-Jours, mais sans y parvenir. Il essaie de jouer la carte de l'unification italienne de manière à s'attribuer un rôle
et une position de repli par rapport à l'Autriche, mais la défaite de Tolentino (2 et 3 mai 1815) met fin à ses espoirs. Etant donné les circonstances, le fait d'accoster à Pizzo
(province de Vibo Valentia en Calabre, Italie) a des allures de tentative de suicide. Il est fait prisonnier, puis fusiller. Murat donne lui-même l'ordre de tirer, le 13 octobre 1815.
Antoine-Jean Gros, par François Gérard Le peintre de l'œuvre : "Portrait équestre de Joachim Murat", 1812 - (musée du Louvre - Paris) Effigie de Murat
Gros présente Murat en train de superviser des manœuvres militaires aux abords de Naples, avec en fond Pièce du royaume de Naples
le Vésuve. Il chevauche, en roi de Naples, "à la mamelouk", avec un sabre turc et son cheval prêt à bondir.
Antoine-Jean Gros, baron Gros, né à Paris le 16 mars 1771 et décédé le 25 juin 1835 à Meudon (92-Hts-de-Seine).
Un père, peintre miniaturiste et une mère pastelliste, il apprend à dessiner dès l'âge de six ans.
Il entre à l'atelier de Jacques-Louis David (1748-1825, peintre, Académicien), tout en poursuivant ses études au
collège Mazarin (1662/88, collège des Quatre-Nations, actuellement Institut de France). En 1793, il quitte la France
pour l’Italie. Il vit à Gênes de sa production de miniatures et de portraits. Il visite Florence, puis revient à Gênes,
où il rencontre Joséphine de Beauharnais (1763-1814) et la suit à Milan. Le 15 nov.1796, Gros est présent avec
l’armée près d’Arcole (Italie), où Bonaparte plante le drapeau de l'armée d'Italie sur le pont. Napoléon Bonaparte
lui commande à Milan un tableau sur cette victoire, dont il est satisfait. Il retrouve Paris, et installe son atelier
aux Capucins en 1801. Napoléon lui commande plusieurs tableaux, dont la "bataille d'Aboukir" (1806). En 1808,
il est décoré par Napoléon, à l'occasion du Salon où il expose la "Bataille d’Eylau". En 1810, ses "Madrid"
et "Napoléon aux pyramides", montrent un déclin de sa peinture. Charles X (1824-1830), lui attribue
le titre de baron en 1824, pour ses œuvres "François 1er de France" et "Charles Quint" (musée du Louvre).
En 1815, il s'exile à Bruxelles. En 1816, il reprend l'atelier de David et enseigne. Mais l'avènement de la peinture
romantique et son succès à partir de 1820, le plonge dans le doute, il se sent délaissé et en proie à des difficultés
personnelles, ce qui le décide à se suicider, par noyade dans la Seine, le 25 juin 1835, près de Meudon.