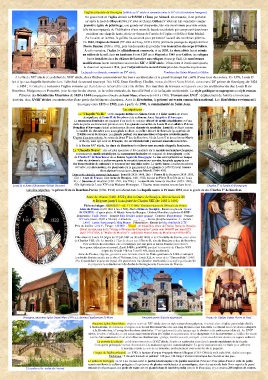Page 10 - Journal Culturel de Metz - 2022-05
P. 10
L'église prieurale de Souvigny (édifiée au Xe siècle et remaniée entre le XIe et la Révolution française).
On ignore tout de l’église donnée en 915/920 à Cluny par Aimard. En revanche, il est probable
qu’après la mort de Mayeul (994, IVe abbé de Cluny), Odilon (Ve abbé) ait fait construire comme
première église de pèlerinage, une grande nef charpentée, très vite transformée pour être voûtée.
Elle fut accompagnée de l’édification d’une nouvelle façade occidentale qui comprenait deux tours
encadrant une chapelle haute, située au-dessus de l’entrée de l’église et dédiée à Saint Michel.
Par la suite, un narthex, la galilée, fut construit pour permettre l’accueil des nombreux pèlerins.
En 1063, Hugues de Semur (VIe abbé de Cluny, 1049 à 1109), profita du passage du légat pontifical
Pierre Damien (1058 à 1072), pour lui demander de procéder à la translation du corps d’Odilon.
À cette occasion, l’église fut officiellement consacrée, et en 1095, les deux abbés furent réunis
au milieu de la nef, dans un tombeau. Entre 1267 pour Mayeul et 1345 pour Odilon, les reliques
furent installées dans les châsses de l'armoire aux reliques (transept Sud). De nombreuses
modifications furent entreprises au cour des XIIe et XIIIe siècle : 2 bas-côtés et 2 nefs sont ajoutés,
le chœur est repoussé à l'Est, pour l'adjonction du second transept et des chapelles rayonnantes.
La façade occidentale, remaniée au XVe siècle. Tombeau des Saints Mayeul et Odilon.
À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, deux flèches couronnèrent les tours occidentales et le grand transept fut coiffé d’une tour de croisée. En 1376, Louis II
fait ériger sa chapelle funéraire dans l’aile Sud du second transept. Dés 1432, Dom Geoffroy Chollet, moine du Mont Saint-Michel, est nommé 28e prieur de Souvigny, de 1424
à 1454 ; il s’attache à restaurer l’église romane qui était dans un lamentable état et le cloître. Des marchés de travaux sont passés avec les architectes du duc Louis II de
Bourbon, Maignon puis Poncelet, pour la reprise du chœur, de la voûte centrale, du bas-côté Sud et de la façade occidentale. Le style gothique se superpose au style roman.
Présence des Bénédictins Mauristes de 1629 à 1644 (congrégation d'érudits de Saint-Maur, effective de 1618 à 1790). Travaux aux XVIIe : déplacement de l'entrée et nouveaux
dortoirs. Aux XVIIIe siècles : reconstruction d'une partie des bâtiments claustraux. Avec la Révolution, le prieuré est vendu comme bien national. Les Bénédictins reviennent à
Souvigny entre 1875 et 1905, puis à partir de 1990, la communauté de Saint-Jean.
Les sépultures :
La "Chapelle Vieille" : cette chapelle dédiée à la Sainte-Croix et à Saint André est le lieu
de sépulture de Louis II de Bourbon et de sa femme Anne Dauphine d’Auvergne.
Le monument funéraire est composé d’un socle de calcaire décoré de motifs héraldiques et d’une
dalle de pierre anciennement peinte en noir. Les gisants en marbre de Louis II et en albâtre d’Anne
Dauphine d’Auvergne étaient polychromes. Ils sont chargés de symboles. Louis II est décrit comme
le modèle du chevalier avec à ses pieds le chien, au collier décoré de fleurs de lys symbole de
fidélité au roi de France. Les gisants portent des marques liées à l'époque révolutionnaire.
D'après d'anciens relevés, les restes de Jean Ier duc de Bourbon, fils de Louis II et de sa femme Marie
de Berry, ainsi que ceux de François, duc de Châtellerault y seraient ensevelis sous terre.
À la fin du XVe siècle, les ducs de Bourbon font élever une seconde chapelle funéraire.
La "Chapelle Neuve" : elle est plus spacieuse et fut construite sur le modèle des Saintes-Chapelles,
foisonnant de motifs héraldiques. Le monument funéraire est composé de deux gisants : celui
de Charles Ier de Bourbon et de sa femme Agnès de Bourgogne. Le duc est représenté en longue
robe de cérémonie et sa femme porte le surcot échancré sur sa robe, les pieds appuyés sur
des lions symbole de puissance et reposent sur une dalle noire. La partie basse a malheureusement
été vidée, à la Révolution, des pleurants qui la garnissaient. Les gisants (v.1450-53) sont l'œuvre
du sculpteur bourguignon Jacques Morel (1390-1459).
Dans cette chapelle reposent également : Jean II (1426-1488, fils) / Pierre II de Beaujeu (1438-1503,
fils) / Anne de France, (dite Anne de Beaujeu, 1461-1522, épouse de Pierre II et fille du roi Louis
XI). / Suzanne de Bourbon (1491-1521, leur fille) / Louise Marie Anne de Bourbon (1674- 1681),
Louis II et Anne d'Auvergne ©Paul-Saccard fille légitimée de Louis XIV et de Madame Montespan. / D'autres restes seraient encore dans le sol. Charles Ier et Agnès de Bourgogne
Dernière sépulture : le prince Sixte de Bourbon-Parme (1886- 1934) est inhumé dans la chapelle neuve le 19 mars 1934, sous le gisant du duc Charles Ier de Bourbon.
Anne de France (1461-1522), dite la Dame de Beaujeu, fille de Louis XI
et Régente jusqu'à la majorité de Charles VIII (de 1483 à 1491)
Fiche technique : 03/07/2017 - réf. 11 17 096 - Grandes Heures de l'Histoire de France
Anne de France (avril 1461 à nov.1522), dite la Dame de Beaujeu - Dessin et gravure : Louis
BOURSIER - d´après photo © Musée Anne-de-Beaujeu / Jérôme Mondière et photos © BNF -
Impression : Taille-Douce - Support Bloc-feuillet, papier gommé - Couleur : Polychromie - Format :
TP Ovale (maxi, 40,85 x 52 mm) - Dentelure : ___ x ___ - Barres phosphorescentes : 2 - Faciale :
1,46 € - Lettre Verte jusqu'à 100g France - Présentation : Extrait du bloc-feuillet de 2 TP -
Prix du feuillet : 2,92 € - Tirage : 330 000 - Visuel : en médaillon, Anne de France, Dame de Beaujeu
(détail du triptyque de la "Vierge à l'Immaculée Conception", peint vers 1496/97 par Jean HEY
(actif 1475/1505, le "Maître de Moulins") - cathédrale Notre-Dame de Moulins-sur-Allier (03).
Fille aînée de Louis XI (règne du 22 juil.1461 au 30 août 1483) et de Charlotte de Savoie, sœur aînée
de Charles VIII, elle fut mariée à l’âge de douze ans à Pierre II, sire de Beaujeu et duc de Bourbon.
Pour sa force de caractère, elle est désignée par son père le roi de France pour exercer
la régence (éducation et conseil, d'août 1483 à juin1491) pendant la minorité de Charles VIII
(règne du 30 août 1483 au 7 avril 1498, décès accidentel).
Anne de France, régente, gouverna avec fermeté, réunit les États généraux de 1484 et vainquit
la révolte féodale menée par le duc d’Orléans, futur Louis XII, au cours de la "Guerre folle" (1485-
88). Consolidant le pouvoir royal, elle paracheva l’unification territoriale accomplie par Louis XI
en préparant le rattachement du duché de Bretagne à la Couronne de France.
Souvigny, ancienne église Saint-Marc (XIIe s.), devenu l'auditorium St-Marc Ancienne porte d'accès au prieuré Orgue de l'église Saints Pierre et Paul
L'escalier et le jardin du prieuré Ancienne église Saint-Marc : érigé au cours du XIIe siècle dans un style roman bourguignon, il servait alors d’église paroissiale dédiée
à Notre-Dame. Du bâtiment d’origine seule la nef fut conservée avec ses cinq travées et ses bas-côtés. Le chevet semi-circulaire a disparu
à la Révolution, à l’exception des deux absidioles. C’est également à cette époque que le clocher a été entièrement détruit. Au XVIIe
siècle, la voûte s’effondra, ce qui amena une restauration de l’église et en particulier de la charpente et de la couverture. L’édifice fut vendu
comme bien national et il eut alors diverses destinations : grange, marché couvert, entrepôt ; c’est actuellement devenu un espace culturel.
La porterie du prieuré : ce bâtiment remonte au XVIIe siècle, d'après un cartouche situé dans la partie supérieure de la façade.
Cette porte principale menait directement à la maison du prieur commendataire. La porte monumentale fut bâtie pour affirmer
la marque royale au sein de ce domaine, anciennement sous contrôle de la papauté.
L'orgue de l'église prieurale : en 1783, le facteur d'orgue François-Henry Clicquot (1732-1790) du roi Louis XVI, réalise cet orgue.
Technique : 3 claviers manuels et pédalier / 28 jeux / 44 rangs / traction mécanique des claviers et des jeux.
Le jardin de Souvigny : il est à mi-chemin entre le jardin à la française et le jardin médiéval. Présence d'une pièce d'eau et doté de petits
carrés surélevés de culture potagère et la présence de plantes médicinales et aromatiques, dans des carrés de buis. Pour rappeler le passé
viticole du département, des pieds de vigne ont été plantés dans le fond du jardin (vin de St Pourçain). Il y a environ 200 espèces de rosiers.