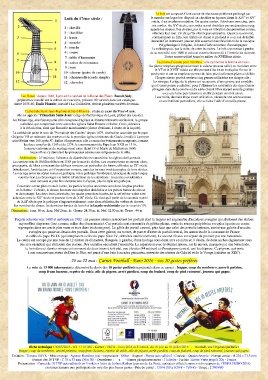Page 13 - Journal Culturel de Metz - 2016-05
P. 13
Les Roses : depuis 1810, Lyon est la capitale de la Reine des Fleurs. Benoit Sédy, Le luth est composé d''une caisse de résonance piriforme prolongé par
pépiniériste installé sur la colline de Fourvière, présente 90 variétés dans son catalogue. le manche sur lequel est disposé un cheviller en équerre.Entre le XIVe et XVe
Entre 1835-40, Emile Plantier, installé à La Guillotière, obtient plusieurs variétés de semis.
siècle, il est en pleine mutation. De quatre cordes, il évoluera vers cinq, puis
six cordes. Au XVe siècle, ses cordes seront doublées par un deuxième rang
appelé les chœurs. Les chœurs, par la mise en vibration des premières cordes,
vibrent à leur tour. On dit qu''ils vibrent par sympathie. Quant à sa sonorité,
contrairement au fifre, son timbre est chaud et profond et a un son de faible
intensité.Cet instrument joue un rôle essentiel dans l'évolution de la musique.
Polyphonique à l'origine, il donna l'idée novatrice d'accompagner
la mélodie puis, par la suite, de créer les suites. Le luth commence à perdre
de sa notoriété vers 1680 et cela est essentiellement dû à l''arrivée du clavecin.
Il sera encore utilisé jusqu'au milieu du XVIIIème siècle.
La plume d’oiseau pour l'écriture : elle symbolise la femme écrivain.
La plume remplace progressivement le calame (roseau taillé) en Occident entre
le VIe et le XVIIIe siècle car elle permet d’écrire en traits plus fin sur le
parchemin et car sa souplesse permet de faire plus facilement pleins et déliés.
Chaque oiseau produit environ cinq pennes utilisables sur chaque aile :
les rémiges. La tige de la plume est recouverte d’une graisse qui empêche
que l’encre puisse y adhérer ; pour l’éliminer les extrémités des tiges étaient
plongées dans de la cendre ou du sable chaud. Elles étaient ensuite grattées
avec une lame puis laissées à vieillir pendant environ un an.
Leur taille, dernière étape avant utilisation, nécessite une connaissance
et une habileté particulière, elle se fait à l’aide d’un taille-plume.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Etienne : située au cœur du Vieux-Lyon,
elle est appelée "Primatiale Saint-Jean" (siège de l'archevêque de Lyon, primat des Gaules).
Au Moyen-âge, elle faisait partie d'un complexe d'églises et d'autres bâtiments ecclésiaux, le groupe
cathédral, qui comprenait entre autres les églises Saint-Etienne et Sainte-Croix, détruites
à la Révolution, ainsi que l'actuelle manécanterie (chœur d'enfants, à droite de la façade).
La cathédrale porte le nom de "Primatiale des Gaules" depuis 1079, distinction accordée par le pape
Grégoire VII en mémoire des martyrs et de la première église chrétienne de Gaule, fondée à Lyon par
saint Pothin vers 160 après JC. Eglise d'importance, elle a connu des événements marquants, comme
les deux conciles de 1245 et de 1274, le couronnement du Pape Jean XXII en 1316,
la messe en honneur du mariage royal entre Henri IV et Marie de Médicis en 1600.
Aujourd'hui s'y déroulent les principales cérémonies religieuses de la ville.
Architecture : à l'intérieur, l'absence de déambulatoire caractérise les églises du Lyonnais.
La construction de l'édifice débute en 1165 par le mur du cloître. Les constructeurs se servent alors,
pour partie, de blocs provenant des édifices romains, en particulier du forum, effondré au IXe siècle.
Initialement, l'architecture est d'inspiration romane, mais les travaux vont durer plus de trois siècles.
Le mariage entre les styles roman et gothique, voire gothique flamboyant, témoigne de cette longue
construction.La chronologie est lisible à l'intérieur de la cathédrale : les parties occidentales
sont romanes et plus l'on s'avance vers la façade, plus le style est gothique.
Construite sur un plan en croix latine, les parties les plus anciennes sont donc les plus proches
de la Saône : l’abside, le chœur, les murs des chapelles absidiales et les parties basses du chevet
et du transept. Les deux tours orientales, les quatre premières travées de la nef et leur voûte sont
achevées entre le XIIe siècle et premier tiers du XIIIe siècle. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié
du XIIIe siècle que le gothique s'impose totalement : sont alors réalisées, les voûtes du chevet,
les verrières du chœur, les dernières travées de la nef et la façade occidentale (sur le visuel du TP).
Dimensions : long. 80 m , larg. Nef 26 m, ht. Chœur: 24,30 m, ht. Nef. 32,50 m, ht. Tours : 44 m
Façade achevée vers 1480 et nettoyée en 1982 : au premier niveau se trouvent les portails dont la largeur est augmentée d'arcatures aveugles qui abritaient des statues
aujourd'hui disparues (tout comme celles des ébrasements). Ces portails sont surmontés de gâbles pleins, ornés de rosaces polylobées aveugles (quatre au centre
regroupées dans un cercle plus vaste et trois dans les écoinçons). Le gâble du portail central, plus haut que celui des portails latéraux, atteint une galerie d'arcades
aveugles qui passe au-dessus des portails. Dans cette galerie, on trouve, de part et d'autre du portail central, les armoiries de la couronne de France
et celles du pape Pie IX (qui remplacent celles du pape Sixte IV, détruites antérieurement). Le second niveau est séparé du premier par une balustrade.
Le centre est occupé par une rose de 12 mètres de diamètres, flanquée, à gauche, d'une horloge sous deux arcs en mitre et, à droite, de deux niches (également sous
des arcs en mitre) qui abritaient des statues. Des tourelles encadrent l'ensemble. La séparation avec le dernier niveau, est là encore, marquée par une balustrade.
Le troisième et dernier niveau est composé de deux tours à toit plat, peu élevées (44 mètres) et d'un pignon central, qui les dépasse. Ce pignon, qui porte
à son sommet une statue de Dieu le Père, est percé d'une baie à arcades géminées, entourée des statues de Gabriel et de la Vierge (refaites au XIXe).
20 au 22 mai : Carnet Football - Euro 2016 - vos 10 gestes préférés
Le vote de 13 000 internautes a déterminé le choix des 10 gestes préférés représentés dans ce carnet : frappe, coup du sombrero, amorti poitrine,
coup franc lucarne, reprise de volée, aile de pigeon, arrêt gardien, coup du foulard, coup de pied retourné, joueuse qui gagne.
Fiche technique : 30/05/2016 - réf. 11 16 484 - Carnet : UEFA - Euro 2016 de Football, du 10 juin au 10 juillet 2016 - Football, vos 10 gestes préférés :
frappe, coup du sombrero, amorti poitrine, coup franc lucarne, reprise de volée, aile de pigeon, arrêt gardien, coup du foulard, coup de pied retourné, joueuse qui gagne.
Création : Tomasz USYK - Mise en page : Agence Huitième jour - Impression : Offset - Support : Papier auto-adhésif - Couleur : Quadrichromie - Format carnet : H 234 x 73,5 mm
Format des 10 TVP : C 33 x 33 mm (30 x 30) - Dentelures : __ x __ - Barres phosphorescentes : 1 à droite - Faciale : Lettre Verte jusqu'à 20g - France
Présentation : Carnet de 10 TVP auto-adhésifs en 3 volets + lettre de Jérôme Rothen (parrain de La Poste, opérateur officiel courrier-colis-express de l’UEFA EURO 2016)
en remerciements aux participants du vote des plus beaux gestes - Prix du carnet : 7,00 € (10 x 0,70 € = 7,00 €) - Tirage : 2 500 000