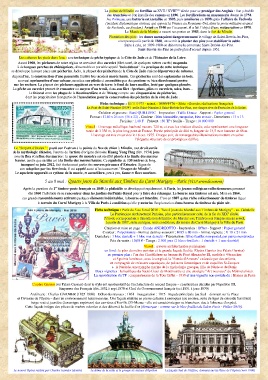Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2016-05
P. 3
La pointe de Mindin est fortifiée au XVII / XVIIIème siècle pour se protéger des Anglais : l'on y établit
des tranchées et l'on installe des canons en 1696. Les fortifications en maçonnerie datent de 1754.
Au Pointeau, une batterie est installée en 1893, puis améliorée en 1898 après l'affaire de Fachoda
(incident diplomatique sérieux, qui opposa la France au Royaume-Uni, dans le poste militaire avancé
de Fachoda, au Soudan). Arasé en 1940 par l’occupant, il a fait l’objet d’une restauration en 1970.
Le Musée de la Marine a ouvert ses portes en 1983, dans le fort de Mindin.
Plantation des pins : les dunes menaçaient dangereusement le village de Saint-Brevin-les-Pins,
c'est pourquoi à partir de 1860, on se mit à planter des pins pour stabiliser le sable.
Suite à cela, en 1899-1900 on dénomme la commune Saint-Brévin-les-Pins.
Saint-Brevin-les-Pins ne porte plus d'accent depuis 1951.
Des cabanes les pieds dans l'eau : une technique de pêche typique de la Côte de Jade et de l'Estuaire de la Loire.
Avant 1900, les pêcheurs de notre région se servaient d'un carrelet (filet carré, de quelques mètres carrés) suspendu
à de longues perches de châtaigniers, démontable et portable appelé "bois debout". La pratique de cette technique
se développe laissant place aux pêcheries. Jadis, la plupart des pêcheries de la Côte de Jade étaient dépourvues de cabanes.
Aujourd'hui, la construction d'une passerelle facilite leur accès à marée haute. Ces pêcheries sont des esplanades en bois,
souvent agrémentées d'une cabane, montées sur pilotis et accessibles par des pontons ou bien directement posées
sur les rochers. La plupart des pêcheurs appâtent en vers de terre le fond de leurs mailles, lesté par quelques plombs.
La pêche au carrelet permet de remonter au moyen d’un treuil, dans son filet : éperlans, plies ou carrelets, soles, bars...
Le littoral entre les plages de la Boutinardière et de l'Etang compte une cinquantaine de pêcheries,
dont les propriétaires font partie de l'Association pour la conservation des pêcheries de la côte de Jade .
Fiche technique : 10/11/1975 - retrait : 10/09/1976 – Série : Grandes réalisations françaises
Le Pont de Saint-Nazaire (1954) : relie Saint-Nazaire à Saint-Brévin-les-Pins, sur chaque rive de l'estuaire de la Loire.
Création et gravure : René QUILLIVIC - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé
Format : H 40 x 26 mm (36 x 22) - Couleur : Bleu hirondelle, turquoise, bleu et noir - Dentelures : 13 x 13
Faciales : 1,40 F – Présent. : 50 TP / feuille - Tirage : 10 000 000
Visuel : L'ouvrage métallique haubané mesure 720 m, et avec les viaducs d'accès, cela représentent une longueur
totale de 3 356 m, le plus long pont de France. Portée principale de 404 m, largeur de 13,5 m et hauteur de 68 m.
L'ouvrage est mis en service le 18 oct. 1975. Chaque soir, de remarquables illuminations mettent en scène
l'élégante structure de ce prestigieux édifice.
Le "Serpent d'Océan " : posté sur l’estran à la pointe du Nez de chien à Mindin, tout droit sortie
de la mythologie chinoise, l'œuvre de l'artiste d'origine chinoise Huang Yong Ping (fév. 1954) joue
avec le flux et reflux des marées : la queue du monstre est en effet placée à la limite des marées
basses, tandis que sa tête est à la limite des marées hautes. Ce squelette de 130 mètres de long,
inauguré en juin 2012, fait dorénavant partie des œuvres pérennes d’Estuaire. Signe de
son adoption par les Brevinois, il est appelé aussi affectueusement "Dragon de Mindin".
Le squelette apparaît au rythme de la marée, et accueillera, peu à peu, faune et flore marines.
5 au 8 mai : Quatre jours du Marché aux Timbres du Carré Marigny - Paris (VIIIe arrondissement)
Après la parution du 1er timbre-poste français en 1849, la philatélie se développait rapidement. A Paris, les jeunes collégiens collectionneurs prennent
dès 1860 l'habitude de se rencontrer dans les jardins du Palais-Royal pour y faire des échanges. La bourse aux timbres est née. Mais en 1864,
ces grands rassemblements attirant quelques éléments indésirables, la bourse est interdite. C'est en 1887 qu'un riche collectionneur de timbres lègue
le terrain du Carré Marigny à la Ville de Paris à condition qu'elle y autorise l'implantation d'une bourse de timbres de plein air.
Fiche technique : Paris du 5 au 8 mai 2016 - "Les 4 jours du Marché aux Timbres de Marigny" - av. Gabrielle
Le Patrimoine Architectural Parisien, plus particulièrement celui de la fin du XIXe siècle.
Période correspondant à l'installation définitive du Marché aux Timbres sur l'emplacement actuel,
à partir de 1887, suite au lègue, sous conditions, du terrain du Carré Marigny à la Ville de Paris.
Création et mise en page : Claude ANDREOTTO - Impression : Offset - Support : Papier gommé
Couleur : Polychromie - Format du bloc-souvenir : H 85 x 80 mm - format vignette : V 18 x 21 mm
Dentelure : 1 bloc dentelé + 1 bloc non dentelé - Présentation : Bloc-feuillet non-postal, par paires numérotées
Prix de vente : 10,00 € - Tirage : 2 500 jeux (2 blocs-feuillets : 1 dentelé + 1 non-dentelé)
Visuel : œuvres architecturales parisiennes
en fond : le plan du métro parisien et la grande façade Sud de l'Opéra Garnier (ou Palais Garnier)
au premier plan : l'un des Candélabres en bronze du Pont Alexandre III, modèle à 4 branches
et 5 points lumineux, avec à son pied, la "Ronde d'Amours" exécutée par des enfants,
en compagnie de créatures aquatiques, de poissons fantastiques et de coquilles St-Jacques
+ la Néréïde, une nymphe marine de la mythologie grecque, fille de Nérée et de Doris.
Deux vignettes : la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et une enseigne "Art nouveau" du Métro parisien.
La reproduction du TP : cinquantenaire de la Tour Eiffel - 1939 et une vignette non-postale du : Blason de Paris
L'opéra Garnier (ou Palais Garnier) dont le style est représentatif de l'architecture du second Empire – construction décidée par Napoléon III,
Empereur des Français (déc.1852 à sept.1870 et Chef du Gouvernement français (oct.1851 à janv.1870)
Architecte : Charles GARNIER (1825-1898) - Début des travaux : 1861 - inauguration : 1875 - Façade principale (au Sud – donnant sur la Place
et l'Avenue de l'Opéra – dans un environnement haussmannien. Une façade réalisée en pierre calcaire à entroques (ou encrine, reste de tiges de crinoïde fossilisés)
beige rosé et jaunâtre (Jurassique supérieur) des carrières d'Euville (55-Meuse - elle est caractérisée par sa blancheur, due à l'absence d'oxyde).
Cette façade intègre des pièces de marbre colorées et des décors à la feuille d'or (Remarque : comme sur le bloc-feuillet du Salon Paris - Philex-2016).
Le nouvel Opéra réalisé par Charles Garnier (dessin) Le dôme de la salle et le groupe de statues d'Apollon La façade Sud de l'édifice, donnant sur la Place de l'Opéra (vers 1900)